 English
English Français
Français
Lu dans la presse
|
Publié le 24 Janvier 2022
L'article de presse que vous avez le plus lu cette semaine
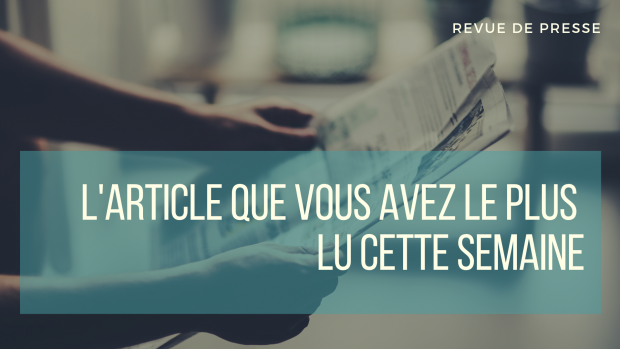
Cet article avait été publié dans le newsletter du 24 janvier 2022. Il est l'article de presse que vous avez le plus lu cette semaine.
France - Rescapée d’Auschwitz, elle raconte l’horreur des camps : "J’ai tellement peur que la mémoire s’efface"
Publié le 21 janvier dans Le Parisien
Le 27 janvier 1945, dans la Pologne occupée, l’Armée Rouge libérait le camp d’Auschwitz-Birkenau, où l’on estime que plus d’un million de personnes ont été exterminées. Denise Holstein y a été déportée à l’âge de 17 ans, quelques mois après ses parents, qui ont péri dans les chambres à gaz. À 94 ans, cette femme n’a rien oublié, ni l’horreur, ni le froid, ni la faim, ni le docteur Mengele, ni la perversité nazie, ni les enfants qu’elle accompagnait et qui ne sont jamais revenus.
Elle nous reçoit longuement chez elle, sur les hauteurs de Juan-les-Pins (Alpes-Maritimes), d’où l’on prend le temps de regarder la Méditerranée derrière les baies vitrées. Calme, apaisante. Denise Holstein a longtemps témoigné dans les collèges ou les lycées avant de ne plus en avoir la force. Aujourd’hui, elle redoute que la mémoire collective s’estompe, que les plus jeunes se détournent de cette tragédie, que l’on n’en parle plus au prétexte que ce serait de « l’histoire ancienne ».
Dans quelles circonstances avez-vous été arrêtée ?
DENISE HOLSTEIN. Mon père était dentiste à Rouen et, d’une certaine manière, c’est son optimisme qui l’a tué. Il y avait de nombreux soldats allemands qui venaient à son cabinet, des ennemis que papa soignait et qui lui disaient souvent qu’il fallait partir, que nous allions être arrêtés parce que nous étions juifs, mais il n’y a jamais cru. Et puis, le 15 janvier 1943, nous avons finalement été emmenés à Drancy. Avec mes parents, mais sans mon petit frère, qui avait été envoyé en zone libre.
C’est dans ce camp que j’ai eu 16 ans. Je me souviens que, ce jour-là, papa m’a dit : « Je ne sais pas où on sera pour tes 17 ans, ma cocotte » – il m’appelait toujours « ma cocotte » –, « mais je te promets que, pour tes 18 ans, tu auras une belle fête. » Et je ne l’ai jamais revu. Maman a été sélectionnée pour monter à bord d’un train en direction d’Auschwitz. Papa a décidé de partir avec elle, pour ne pas la laisser seule. Il pensait qu’on se retrouverait plus tard.
Vous avez 16 ans, et vous vous retrouvez seule…
Oui, mes parents sont partis en pensant que leur fille était sauvée. J’ai alors été envoyée à Louveciennes, dans les Yvelines, un centre d’accueil pour les tout-petits dont les familles avaient été déportées, une sorte d’orphelinat. J’y suis allée en tant que monitrice pour m’occuper de neuf enfants. Il y avait Eugénie, qui pleurait souvent et m’appelait maman, Estelle, qui faisait des cauchemars, Samy, le seul petit garçon… Mon rôle était de les distraire, de sortir jouer avec eux, de les promener, je ne les quittais jamais. Nous dormions dans la même chambre, je mangeais avec eux, les lavais, les couchais… Et puis, un matin, en juillet 1944, on sonne à la porte, on vient nous arrêter. Nous sommes d’abord regroupés à Drancy puis, une semaine plus tard, sur ordre d’Aloïs Brunner, qui dirigeait le camp francilien, envoyés à Auschwitz.
« Il y avait ces fours crématoires et je me souviens d’une femme qui m’a montré ces cheminées et m’a dit : Tiens, tes parents sont passés par là. » Denise Holstein
Vous saviez où vous alliez ?
Pas du tout. Nous avons passé trois jours à bord de ces fameux wagons à bestiaux, et sommes arrivés en pleine nuit. Nous ignorions où nous étions et, sur le quai, la sélection a immédiatement commencé. Il y avait une petite fille qui pleurait, je suis allée vers elle pour la consoler. Elle était perdue. Tout à coup, un déporté m’a dit à l’oreille, pour que personne n’entende, mais de manière très autoritaire : « Laisse la petite, ne t’en occupe pas, ne prends surtout pas d’enfant dans tes bras, ça va faire du savon. » Je ne comprenais pas, je pensais qu’il était fou. Mais la petite fille a effectivement été emmenée à la chambre à gaz. Si j’avais tenu sa main, j’aurais été gazée une heure après mon arrivée, comme tous les enfants, mes petits de Louveciennes, qui ont été exterminés le jour même.
Et ensuite ?
J’essayais de comprendre où j’étais, mais personne ne parlait français. Je voulais savoir où retrouver mes parents dans ce camp. Il y avait ces fours crématoires qui brûlaient nuit et jour, qui dégageaient de la fumée orange, et je me souviens d’une femme qui m’a montré ces cheminées et m’a dit : « Tiens, tes parents sont passés par là. » Je me suis dit qu’elle aussi était folle, comment pouvais-je comprendre cette phrase ? J’ai su plus tard qu’elle avait raison. Ensuite, nous avons été tatoués, marqués à vie.
Comment était la vie à Auschwitz ?
Terrible ! La faim, la peur continuelle, le danger à chaque instant, le faux pas qui conduit à la mort… Et puis, les kapos qui nous faisaient faire des tâches idiotes, porter des machines à coudre d’un bout à l’autre du camp, pour le plaisir de nous briser, chaque matin et chaque soir. Et le pire pour moi : porter des tapis roulés et gorgés d’eau. Vous ne pouvez pas imaginer le poids d’un tapis gorgé d’eau. Il fallait le prendre à deux sur l’épaule et courir dans la neige… Dans l’esprit des nazis, c’était une manière de nous détruire, il n’était pas question que nous en sortions vivants. Si on trébuchait, les kapos riaient et nous donnaient des coups.
Il y avait aussi le froid. La nuit, la température descendait jusqu’à - 30 °C, parfois - 40 °C, on avait les pieds totalement gelés dans nos socques en bois, et à peu près rien pour se couvrir, ni manger. Je me souviens être allée traîner un soir vers les cuisines, où j’ai trouvé des os que les chiens avaient laissés après les avoir rongés. Pendant toute la soirée, j’ai sucé ces os, puis j’ai eu la figure boursouflée par les microbes qu’il devait y avoir dessus.
À Auschwitz, vous tombez malade et vous êtes convoquée par le terrible docteur Mengele…
J’étais au revier, le bâtiment qui servait d’infirmerie, et c’est là qu’un soir, on nous a prévenues que Mengele allait venir. Je n’en avais jamais entendu parler, mais j’ai senti l’affolement général quand son nom a été prononcé. Il venait faire une sélection. Il est arrivé, s’est assis devant un bureau, avec la liste sur laquelle étaient inscrits nos noms, et il nous a appelées les unes après les autres. Il était d’une froideur… On était glacées devant lui qui avait tous les pouvoirs, notamment celui de nous envoyer à la mort. Il suffisait qu’il mette une croix devant notre nom, et on partait à la chambre à gaz. « Holstein Denise »… Cette manière de prononcer mon nom, je l’entends encore quand je vous parle. Depuis ce jour, j’ai toujours préféré que l’on prononce mon nom « Holstène », pour ne pas revivre ce moment-là. Je me suis approchée de lui. Quelques secondes. Je n’ai pas été envoyée à la mort.
Cet enfer va prendre fin à la libération du camp…
J’étais allongée, couverte de poux, c’était effroyable, mais quand on a entendu les bombardements, j’ai réussi à aller jusqu’aux soldats alliés qui arrivaient. C’était une question d’heures pour moi, j’étais mourante. Ensuite, nous avons été rapatriés vers la France. Le retour a duré quatre ou cinq jours, c’était difficile, d’abord par la route, en camion, puis en train entre Valenciennes et Paris. Un soir, je discute avec un officier de rapatriement qui me dit : « J’étais à Rouen il y a quelques jours, et je sais qu’il y a un Holstein qui est revenu. » Et là, pour moi, ça a été un moment de folie, d’immense joie, je me suis dit que mon papa était rentré.
Quand je suis arrivée à Paris, à la gare du Nord, je ne suis pas allée à l’hôtel Lutetia, où l’on rassemblait les déportés, mais directement chez ma grand-mère, qui habitait à côté de la gare. J’étais tellement faible que je ne pouvais plus avancer, je devais peser 35 ou 40 kg. J’ai sonné. Et quand je suis entrée, j’ai vite compris que ce n’était pas mon père qui était revenu, mais mon frère, qui avait passé la fin de la guerre en zone libre. Tout s’est effondré autour de moi.
Comment réapprend-on à vivre ?
C’était extrêmement difficile, car ma grand-mère, qui n’avait pas été déportée, était convaincue que mes parents étaient vivants, et qu’ils allaient finir par revenir. J’ai dû mentir pendant des mois et des mois, car je savais qu’il était impossible qu’ils soient encore en vie. Ma grand-mère écoutait la radio, me disait : « Tu as entendu, il y a encore des déportés qui reviennent, on en a retrouvé. » Elle les a attendus jusqu’à son dernier jour.
« Malheureusement, aujourd’hui, j’entends des gens dire que ça suffit, qu’on en a déjà assez parlé. C’est terrible. C’est la bêtise humaine. » Denise Holstein
Vous ne pouviez rien lui dire…
Ce n’est pas possible de raconter des choses pareilles à une mère. Je n’en parlais à personne, en fait. J’avais l’impression que les gens ne comprenaient rien, que c’était tellement loin de tout ce qu’ils pouvaient imaginer. Il m’est même arrivé d’entendre des choses stupides. Je me souviens d’une femme qui m’a demandé ce que l’on nous donnait le matin comme petit-déjeuner, si on avait du sucre, une cuillère ! Comme si on avait le choix entre du café, du thé… Tu parles ! On avait une gamelle accrochée à nos habits et on récupérait un peu d’eau à peine bouillie avec un bout de pain, voilà ce que c’était, notre petit-déjeuner…
Mais vous avez témoigné dans les collèges et les lycées…
Petit à petit, j’ai commencé à transmettre, et je me suis aperçue que les enfants étaient ceux qui posaient le plus de questions. Malheureusement, aujourd’hui, j’entends des gens dire que ça suffit, qu’on en a déjà assez parlé. C’est terrible. C’est la bêtise humaine. Comment peut-on dire qu’on en a assez parlé ? J’ai tellement peur que la mémoire s’efface doucement. Et je suis désolée de voir que cela intéresse de moins en moins de monde, que c’est de l’histoire ancienne pour beaucoup. Il y a quelques années, je suis retournée à Birkenau avec des élèves. Sur place, j’ai été outrée, il faisait beau, les gens pique-niquaient dehors, se prenaient en photo, ils s’en foutaient.
Birkenau, où il y a une petite étendue d’eau, près d’un champ de bouleaux…
Je m’y recueille à chaque fois, car c’est près de l’endroit où se trouvaient les chambres à gaz et les fours crématoires, et je me dis que mes parents sont là, dans cette petite mare. C’est ridicule, peut-être, mais comme les nazis ne savaient pas quoi faire des cendres, je me dis qu’ils ont jeté mes parents ici. Ça me fait du bien de savoir que leurs cendres sont peut-être là. Je crois en Dieu, mais ne suis pas du tout pratiquante, et cela m’arrive encore, à près de 95 ans, de me réveiller le matin, et de me dire qu’un jour, je les retrouverai. Quand je les croise, la nuit, dans mes rêves, ils sont encore jeunes…
- “Je ne vous oublierai jamais, mes enfants d'Auschwitz…” par Denise Holstein
Source :
Le Parisien


