 English
English Français
Français
Read in the news
|
Published on 12 October 2020
L'article de presse que vous avez le plus lu cette semaine
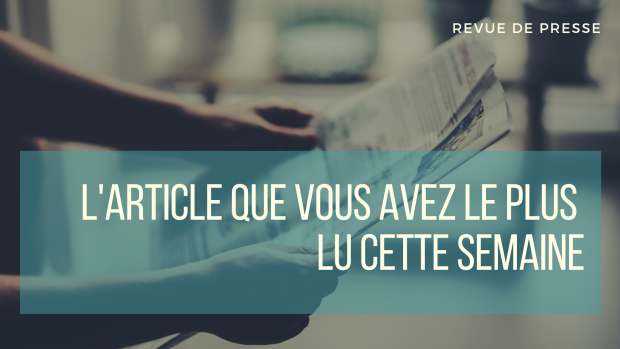
Cet article avait été publié dans le newsletter du 12 octobre 2020. Il est l'article de presse que vous avez le plus lu cette semaine.
France - Simone Schwarz-Bart : "Epouser quelqu’un hors de sa culture, ça dessille votre regard"
Publié le 11 octobre 2020 dans Le Monde
Je ne serais pas arrivée là si…
S’il n’y avait pas eu André, mon mari, mon enchanteur, cet homme au cœur troué. Et s’il n’y avait eu mes grands-parents paternels qui m’ont donné foi en l’amour véritable, l’amour absolu, l’amour entre deux personnes qu’a priori tout sépare mais qui se comprennent et se ressentent de façon mystérieuse. Avoir vu vivre ensemble ces grands-parents splendides, elle, la petite négresse de Saint-Martin, qui ne parlait que le créole et l’anglais, ne savait ni lire ni écrire mais pouvait entrer en contact avec l’invisible, et lui, le fils de négociant en vin installé dans le port de Pointe-à-Pitre, éduqué chez les pères salésiens et amoureux des livres, m’a fait croire en la force des amours impossibles. Je n’étais pas prête à aimer n’importe qui, n’importe comment. Je ne voulais pas d’un coup de cœur facile. Il me fallait du bouleversant. Ma grand-mère me l’avait d’ailleurs prédit : « Ta médaille se met toujours à l’arrière de ton cou ; c’est un signe : tu épouseras quelqu’un qui n’est pas de Guadeloupe, un homme d’une autre culture. »
Evoquait-elle son propre choix ?
Non. Mais je les observais et constatais l’osmose. Elle était entrée à son service comme femme de ménage, pauvre d’entre les pauvres, débarquée de son île, et il l’avait épousée, provoquant sa mise au ban de la communauté blanche et sa ruine immédiate. Ils sont donc allés vivre leur amour sur un îlet en face de Pointe-à-Pitre, respectueux de leurs mutuelles différences. Le soir, il revêtait son costume de drill blanc, avec des boutons dorés, pour s’installer à table et déguster un bon vin, tandis qu’elle préférait dîner de racines, d’igname et de patates douces, assise sur la première marche du perron.
Elle continuait de l’appeler « Monsieur Brumant », ce qui le désespérait. « Quand donc vas-tu m’appeler Amédée, Marie ? », lui demandait-il chaque jour. Rien n’y faisait. Elle ne pensait pas être digne de cet amour qu’il lui proclamait pourtant en français, en anglais, en créole. Mais quand elle a été paralysée, c’est à lui, et à lui seul, qu’elle a demandé de faire ses tresses et de préparer ses repas. Le soir, assis tous deux sur des balancelles sous la véranda, il lui faisait la lecture d’un roman à voix haute. Elle disait : « Vous êtes bien sûr que cette histoire est vraie ? Moi, j’en doute ! » Et ils riaient ensemble. Je n’ai jamais vu la moindre dispute ni la plus petite dissonance. Ce lien entre eux dépassait la raison et la norme. Je me disais : c’est cela l’amour. J’avais cette référence en tête lorsque j’ai rencontré André.
Racontez-nous cette rencontre déterminante.
Je m’en souviens comme si c’était hier. Ma mère institutrice avait voulu que je passe mon bac à Paris pour m’ouvrir l’horizon. Je m’y suis donc retrouvée l’année 1959 en classe de terminale, peu à l’aise dans cette ville immense, encore moins dans son métro. Le 15 mai, en allant chercher le duplicata de ma convocation à l’épreuve de philo, je me suis trompée de station. Et là, devant la bouche du métro Cardinal-Lemoine, alors que je ne savais vers où me diriger, un jeune homme maigre et pâle, affublé d’un manteau qui l’avalait, s’est approché de moi : « Vous cherchez votre chemin ? » Et il a ajouté, en créole : « Vous n’êtes ni de la Martinique ni de la Guyane, mais de la Guadeloupe. » J’en ai été interloquée.
Qu’avez-vous répondu ?
Je l’ai regardé attentivement. Il avait un air paisible. Et de ses yeux émanait une bonté fluide. J’ai pensé : en voilà un qui ne fait pas partie des agités du bocal. Mais j’étais troublée. Je voyais qu’il était jeune et je sentais qu’il était vieux. Quelque chose en lui donnait l’impression d’un monde disparu… Nous avons marché côte à côte, naturellement. Puis il m’a proposé de prendre un café. Je ne m’étais jamais attablée avec un homme seul, mais j’ai accepté, confiante. Il m’a prévenue qu’il n’avait qu’un franc en poche et qu’il faudrait nous abstenir de boire nos cafés à 45 centimes pour rester le plus longtemps possible ensemble. « Nous avons beaucoup à nous dire », a-t-il glissé en souriant. Et j’ai senti que c’était vrai. Arrivés à 14 heures, nous sommes sortis à 23 heures, et nous n’avons pas vu le temps passer. Ma vie venait de basculer.
En aviez-vous la certitude le soir même ?
Je suis partie en me disant que même si je ne revoyais plus jamais cet homme-là, je l’avais aimé comme je n’aimerais plus personne sur terre… Il était pourtant le contraire de ce dont j’avais rêvé. J’étais coquette, je voulais quelqu’un qui sache danser, s’habiller. En une seconde, tout cela est devenu dérisoire.
Cet homme m’ouvrait le monde dans sa férocité et dans son merveilleux. Il me dit qu’il a été ajusteur, éducateur, vendeur, couturier, et aussi communiste, et aussi résistant ; qu’il vient de déposer au Seuil un manuscrit qui lui a demandé un travail immense et qui est un hommage aux siens à jamais disparus. Un caillou blanc posé sur une tombe en fumée. J’écarquille les yeux. Et il me parle de sa famille exterminée à Auschwitz, d’un monde englouti par la Shoah dont je ne sais absolument rien. Mais qui est-il ? Il me dit qu’il est juif. Et j’en suis bouleversée. Il existe encore des juifs ? Je ne les ai rencontrés que dans la Bible. Cela confirme mon impression : cet homme-là a traversé le temps et vient d’une autre planète. Il me dit qu’il a 30 ans, mais il a l’âge de Mathusalem.
Et cela ne vous effraie pas ?
Cela me subjugue. Car au fur et à mesure qu’il me parle de son monde anéanti, de sa richesse, de sa spiritualité, je vois apparaître le mien. Au fur et à mesure qu’il me fait entrer dans son histoire, c’est la mienne qui frémit. La brûlure de la Shoah me renvoie à la brûlure de l’esclavage. Ses interrogations sur l’arrivée des déportés à Auschwitz ravivent mes obsessions sur les pensées du premier esclave ayant mis les pieds sur le sol de Guadeloupe. Et l’image des esseulés de l’Hôtel Lutetia, à Paris, scrutant, en 1945, les listes de convois et rescapés des camps me rappelle celle des miens cherchant à retracer d’où viennent leurs ancêtres africains, quelle tribu, quel pays, quel transport. Je sens l’alliance souterraine de nos histoires et de nos souffrances. J’ai 20 ans et j’ai la sensation de m’être trouvée. Je me sens instantanément mariée à cet homme, dussé-je ne jamais le revoir.
Comment la relation s’est-elle poursuivie ?
Par une correspondance assidue. Il m’envoie des cartes avec les tournesols de Van Gogh dont il est fou. Je les reçois à la pension religieuse dans laquelle ma mère, repartie en Guadeloupe, m’a installée afin que je poursuive mes études à Paris. C’est là qu’un matin de novembre, une de mes amies m’annonce que le prix Goncourt vient d’être décerné à un dénommé André Schwarz-Bart.
Je reste impassible. Mais j’ai envie de hurler de joie. André m’avait dit que si son livre rencontrait un seul lecteur il serait heureux. Alors je pense qu’il va être très heureux. Je n’imagine pas une seconde la fureur que Le Dernier des Justes va déchaîner. La presse découvre l’écrivain, si singulier dans sa tristesse et son intensité. Cependant les polémiques surviennent de toutes parts, y compris des cercles juifs et communistes. André est totalement pris de court.
Vous en parle-t-il ? Pouvez-vous lui être d’une aide quelconque ?
Il n’en dit mot et je me préserve moi-même, consciente que mes pleurs se transformeraient en rivière si je savais qu’on attaque ce garçon sincère et inconsolable. Un jour, il vient m’annoncer qu’il prend le large vers la Guyane. J’en suis glacée, mais de quel droit exprimer ma tristesse ? Lors de notre première rencontre, nous étions convenus que le couple ne devait être ni un piège ni une prison… Notre correspondance devient au fil des mois un lien vital pour l’un et l’autre. On s’écrit tous les jours. Parfois plusieurs fois par jour. Je découvre sa passion pour l’histoire de la Caraïbe, sa volonté de se lancer dans l’écriture d’un cycle de sept romans sur l’esclavage. Oui, lui, le juif, dont tout le monde attend un deuxième livre sur la Shoah.
Quand il revient à Paris, au terme d’un long périple, nous comprenons que nous ne pouvons nous passer l’un de l’autre. Nous emménageons dans une chambre sous les toits. Et le 21 mars 1961, nous nous marions à la mairie de la place Saint-Sulpice. Tout seuls. André ne veut pas de mondanités. Mais il disparaît dans la nuit, me laissant dans les affres de l’incertitude. Regrette-t-il déjà ? Pense-t-il que sa mère aurait préféré qu’il épouse une juive ? Une petite voix me dit que cet homme en péril pourrait se noyer si je n’étais pas à ses côtés.
Un rouleau compresseur lui est passé sur l’âme, chaque jour de sa vie, il voyage vers Auschwitz avec le regret de n’y avoir pas accompagné ses parents… Alors je l’attends. Et il revient au petit matin. J’ai plongé dans son monde avec passion. Par réfraction, il m’a fait découvrir le mien. J’ai pris ma part de ses cauchemars et il a pris les miens.
Vous connaissiez très peu, vous-même, l’histoire de l’esclavage ?
On ne l’apprend pas en Guadeloupe. Mais les discussions avec le groupe d’amis juifs d’André, tous passionnés par la culture yiddish, m’ont donné envie d’interroger mon propre héritage. J’ai commencé à disséquer les contes, les chants, le langage créoles. A noter que des expressions familières comme « Tu m’aimes mais tu ne peux pas m’acheter » sont imprégnées de notre histoire d’esclavage. Que notre autodénigrement a des racines profondes. Je vous assure que c’est une chance d’épouser quelqu’un en dehors de sa culture et de sa communauté ! Cela vous apprend que l’étranger ne l’est pas tant que ça. Ça dessille votre regard et vous ouvre à tous les possibles.
Y compris celui de devenir à votre tour écrivaine ?
J’ai vite compris que la première épouse d’André était l’écriture. Et que si je voulais poursuivre notre histoire avec l’intensité et la symbiose qui la caractérisaient, il fallait que j’écrive. Comment ? Je ne savais pas, je n’osais pas. Mais notre dialogue était tel qu’une collaboration s’est spontanément mise en place pour ses recherches sur l’héritage antillais. Puis il a commencé à me dicter certains passages de son nouveau livre en me disant d’intervenir comme bon me semblait. Je ne voulais jouer alors qu’un rôle de secrétaire, mais peu à peu, je suis entrée dans l’histoire et j’ai fait des propositions qu’André a intégrées à son texte. Et c’est ainsi qu’il a voulu qu’on cosigne Un plat de porc aux bananes vertes, un livre dédié à Aimé Césaire (1913-2008) et à Elie Wiesel (1928-2016) pour signifier le lien entre ces deux expériences de l’extrême : l’esclavage et la Shoah. Et puis je me suis lancée en solo dans l’histoire de Télumée (dans Pluie et vent sur Télumée Miracle), une vieille Guadeloupéenne un peu sorcière que j’ai aimée tendrement. Elle a raté de très peu le Goncourt en 1972.
La parution, la même année, du troisième livre d’André, « La Mulâtresse Solitude », qui évoque le destin d’une combattante contre l’esclavage, a en revanche été très mal accueillie.
Ce fut affreux, stupide, injuste. Des Antillais ont osé prétendre qu’un homme blanc ne pouvait honnêtement écrire sur les Noirs ! Des intellectuels proches des indépendantistes n’ont pas supporté que le grand livre de résistance à l’esclavage soit écrit par un juif ! André en a été meurtri, et moi, je me suis sentie trahie par les miens. Pas une voix ne s’est élevée pour le défendre. Pas un coup de fil pour soutenir sa volonté de relier les hommes, et son droit de parler des Noirs comme des siens. On avait affaire à des rapetisseurs de têtes, des cuiseurs de cervelle lamentables, alors qu’André visait l’universel. Cette incompréhension l’a brisé. Il a rompu tous liens avec le milieu littéraire. Il a continué d’écrire chaque jour des dizaines de feuillets, mais il jetait tout à la poubelle. Son désespoir me dévastait. La vérité, c’est que son livre était paru trop tôt et qu’aujourd’hui, Solitude, l’héroïne de son histoire, est revendiquée par toute la Guadeloupe. Des rues, des écoles, des statues, des institutions la célèbrent. Le petit juif André Schwarz-Bart fait bel et bien partie du patrimoine antillais.
La maire de Paris a inauguré, le 26 septembre, dans le 17e arrondissement, un jardin « Solitude », annonçant l’installation prochaine d’une statue la représentant. Or dans son discours, Anne Hidalgo présentait Solitude non pas comme un personnage de fiction, mais comme une véritable héroïne antillaise dont elle a longuement détaillé la biographie… sans mentionner l’imagination d’André.
Quelle ironie de l’histoire ! En vérité, on ne sait rien de Solitude. Ce nom n’apparaît que sur trois lignes sujettes à caution dans un manuel d’histoire de 1858. Mais André a été si bouleversé par ce nom porté par une esclave qu’il a entrepris de lui construire une biographie imaginaire.
Et c’est là que se produit le miracle : son héroïne est racontée avec une telle sincérité et une telle force, qu’elle en devient plus réelle que réelle, échappe à l’auteur et se transforme en mythe : la voilà emblème de la lutte contre l’esclavage et de tout asservissement de l’homme par l’homme. Quelle aventure grandiose pour un écrivain ! Solitude existe désormais. Solitude est vivante. Chapeau l’artiste ! De là-haut, de l’Ailleurs, je suis sûre qu’André Schwarz-Bart nous fait un clin d’œil amusé.
Cela vous apaise-t-il ?
Disons que cela sonne juste. A sa mort, en 2006, j’ai retrouvé des milliers de notes, amorces de manuscrits, fragments de journaux intimes miraculeusement sauvés de la destruction. Comme s’il avait semé à mon intention une graine d’amour et de mémoire. Alors j’ai entrepris de reconstituer la suite de livres antillais que mon mari n’avait pu achever. Cela me donne une raison de vivre après lui. Cet homme-là, voyez-vous, ne veut pas me quitter.
Source :
Le Monde
