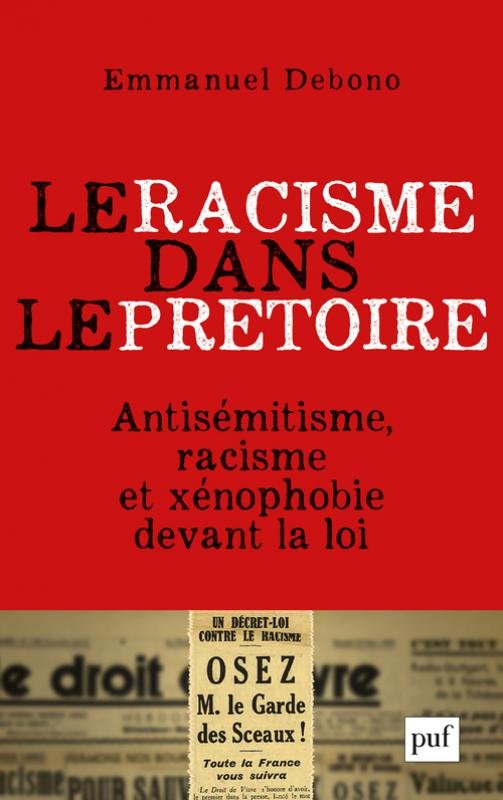English
English Français
Français
Actualités
|
Publié le 14 Novembre 2019
Interview Crif - Entretien avec l'historien Emmanuel Debono sur la judiciarisation du racisme et de l'antisémitisme

Entretien réalisé par Marc Knobel, Directeur des Etudes au Crif
Le Crif : Emmanuel Debono, vous êtes historien et vos nombreuses recherches portent sur les racismes et les antiracismes dans la France contemporaine. Vous publiez en septembre 2019, un livre volumineux et riche : « Le racisme dans le prétoire. Antisémitisme, racisme et xénophobie devant la justice » (PUF), comme une plongée vertigineuse dans les procédures judiciaires qui ont ponctué l’histoire de la France contemporaine. Pourquoi ce choix ? Et quel fut la genèse de ce travail et vos sources ? Comment avez-vous construit le livre ?
Emmanuel Debono : Ma thèse, soutenue en 2010, avait porté sur les premières années d’existence de la Ligue internationale contre l’antisémitisme (LICA, actuelle LICRA), de 1927 à 1940. C’est au cours de cette recherche que j’ai découvert le rôle de cette association dans la revendication d’une loi contre le racisme, effectivement adoptée par décret par le gouvernement Daladier, le 21 avril 1939. Le sujet m’avait intrigué : la loi a-t-elle une réelle valeur pour lutter contre l’expression du racisme et de l’antisémitisme ? En 2015, Gwénaële Calvès, professeure de droit public à l’université de Cergy-Pontoise a fait paraître un petit ouvrage passionnant, Envoyez les racistes en prison ? Le procès des insulteurs de Christiane Taubira (LGDJ) ; elle y détaillait les conditions d’application de la loi contre le racisme du 1er juillet 1972 (loi Pleven) et l’ensemble des facteurs qui pouvaient peser dans les décisions de justice. Pour l’historien que je suis, il m’a semblé que la connaissance du mouvement antiraciste ne pouvait faire l’économie d’un détour par le droit, au regard de cette revendication constante d’une justice opposable aux discours de haine. « Le racisme n’est pas une opinion mais un délit », répète-t-on. Oui, mais encore ? Que dit la loi exactement ? Que peut-on réellement en attendre ? J’ai voulu apporter des réponses à ces questions en me plongeant dans l’Histoire, sachant que les débats et réflexions que suscitent les affaires traitées dans ce livre ont une étonnante résonnance avec l’actualité.
Grâce à la presse militante de la LICA et du Mouvement contre le racisme, l’antisémitisme et pour la paix (MRAP, fondé en 1949), j’ai pu identifier l’ensemble des procédures – une quinzaine entre 1939 et 1972, que j’étudie en resituant les acteurs et les groupements incriminés dans leur contexte : avant-guerre, épuration, guerre froide, décolonisation, mai 68...
J’ai notamment eu recours, dans cette recherche, à des sources judiciaires (jugements et arrêts, dossiers d’instruction, archives d’un avocat…). Ces sources sont très lacunaires. Je les ai donc croisées avec la presse militante, la presse généraliste mais aussi la presse juridique. Les archives des renseignements généraux (archives nationales, archives de la Préfecture de police) apportent de nombreux éclairages sur les protagonistes de cette histoire. Les comptes-rendus des débats parlementaires sont également passionnants lorsqu’il s’agit de mesurer l’écho de certaines affaires dans cet après-guerre où, d’une certaine manière, se poursuit la lutte entre, d’un côté, la Résistance, et, de l’autre, Vichy et les collaborateurs.
Le Crif : Vous couvrez énormément de sujets : de l'antisémitisme hitlérien à l'antisionisme radical en passant par les racismes antinoirs, contre les arabes ou antiblancs. Vous racontez dans le détail, par exemple, l'histoire de la loi Marchandeau, première loi antiraciste, appliquée en France de 1939 à 1972. De quoi s’agissait-il ?
Emmanuel Debono : La « loi Marchandeau », du nom du Garde des Sceaux de l’époque, Paul Marchandeau, sanctionne deux types de délits : l’injure et la diffamation, lorsqu’elles visent un groupe de personnes qui appartiennent, par leur origine, à une « race » ou à une religion. Il est précisé qu’elles doivent avoir eu pour but l’excitation à la haine entre les citoyens ou « habitants », c’est-à-dire les étrangers. Ces dispositions sont introduites dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Il en ira de même pour les modifications apportées par la loi contre le racisme du 1er juillet 1972, dite « loi Pleven », qui succèdera à la loi Marchandeau. Il faut noter que la discrimination, dans sa définition actuelle, n’est pas prise en compte par la loi et que, par ailleurs, les associations antiracistes ne peuvent se constituer parties civiles : l’initiative de l’action judiciaire revient à la victime de l’injure ou de la diffamation, ou au ministère public. Pour autant, les associations, et en particulier le MRAP, vont être extrêmement actives au cours de la période.
Le Crif : On suppose aisément que la loi Marchandeau eut ces très nombreux contradicteurs. Par exemple, vous citez un article de Paris-Soir en date du 26 août 1940 : « La presse française doit avoir la liberté de dénoncer les agissements pernicieux des Juifs » et le 29 août 1940, le Conseil des Ministres présidé par Pétain abroge le décret-loi du 21 avril 1939…
Emmanuel Debono : Au moment de l’adoption de la loi, il y a deux types de contradicteurs : les journalistes ou activistes antisémites, comme Charles Maurras, Louis Darquier de Pellepoix ou Jean Boissel, et les professionnels du monde de la presse, d’authentiques démocrates qui s’inquiètent des restrictions qui pourraient être apportées à la liberté d’expression. Marchandeau est lui-même le directeur d’un journal rémois, L’Éclaireur de l’Est : il défend le projet devant ses confrères, mais, semble-t-il, à contrecœur… Le 27 août 1940, le gouvernement de Vichy abroge la loi, à la grande satisfaction de tout un petit monde politique et journalistique, bien décidé à faire payer les juifs. On connaît la suite… Mais ce que l’on sait moins, c’est que la loi Marchandeau est rétablie avec le reste de la législation républicaine par l’ordonnance du 9 août 1944. Cette fois, il n’y a pas levée de boucliers : les Français ont d’autres chats à fouetter. Et qui songerait à protester, à la Libération, contre le rétablissement d’un texte visant à sanctionner, entre autres délits, les attaques antijuives ?
Le Crif : Et puis, il y a toutes ces affaires judiciaires dont vous parlez très précisément. Certaines d’entre elles n’évoquent plus grand-chose aujourd’hui et pourtant elles ont marqué leur temps. Notamment celle-ci, l’affaire Roos, à un moment encore où les années 1940-1944 sont toujours présentes dans tous les esprits. De quoi s’agissait-il ?
Emmanuel Debono : Pierre Roos est le directeur d’un petit journal nationaliste, Contre-Révolution, dont le premier numéro sort au printemps 1950. En novembre, un article d’une de ses éditions fait l’apologie de « l’antisémitisme à la française », celui de Drumont, et réclame des lois « justes et nécessaires » contre les juifs, pour protéger les vrais Français… mais aussi les juifs eux-mêmes, « contre les tentations de leur nature ou de leur histoire » ! Autrement dit, cinq ans à peine après la découverte de l’ampleur du système concentrationnaire allemand et de la destruction des Juifs d’Europe, des individus réclament publiquement, en France, un statut particulier pour les juifs. À la condamnation en première instance succède un arrêt de la cour d’appel qui relaxe le directeur du journal. Le motif ? Il est reconnu que le rédacteur anonyme s’était démarqué explicitement de « l’ignoble persécution allemande et raciste ». Il était apparu aux juges que l’article faisait appel à la raison et non à la passion...
Le Crif : C’est aussi le procès du maurrassisme… ?
Emmanuel Debono : Oui… et non. Oui parce que Maurras est bien condamné à perpétuité pour trahison, à Lyon, en 1945. Il continue toutefois de répandre son fiel depuis ses lieux d’incarcération, en faisant passer des articles clandestinement, publiés sous pseudonyme dans Aspects de la France. Certains de ses articles sont jugés, en son absence, mais le vieux leader de l’Action française va persévérer, y compris après avoir bénéficier d’une grâce présidentielle en février 1952. Libéré, il reprend officiellement ses activités journalistiques et règle ses comptes. Il n’épargne pas les juifs qui, estime-t-il, « doivent des comptes » à la France. Des poursuites judiciaires sont engagées à l’été 1952 mais il décède le 16 novembre de cette année. Il n’aura jamais eu à répondre devant les juges de ses théories et de ses attaques antisémites.
Le Crif : Et plus tard, Pierre Mendès France est une cible de l’extrême-droite, avec des campagnes abjects… et des affaires qui sont portées devant les tribunaux.
Emmanuel Debono : Mendès France, président du Conseil, est l’objet de multiples campagnes odieuses. Il est notamment la cible de Pierre Poujade et celle de Pierre Boutang, héritier de Charles Maurras. Ce sont les attaques répétées de ce dernier, à l’été 1954, au moment où Mendès France met fin à la guerre d’Indochine et reconnaît l’autonomie interne de la Tunisie, qui conduisent le ministère public à la traduire en justice. Pour étudier ce procès, j’ai eu accès aux archives familiales qui permettent de comprendre le détail de la procédure, l’action des magistrats, l’agacement du Président du Conseil qui s’exaspère de la lenteur de la machine judiciaire, et, finalement, après la condamnation de Boutang, la question de la non-exécution des peines. Cette dernière et celle de la longueur du temps judiciaire, qui n’est pas le temps médiatique, sont à prendre en compte lorsque l’on s’interroge sur la notion de victoire judiciaire. Il faut aussi noter que cela n’est pas sur la loi Marchandeau que s’est appuyée l’accusation mais sur les délits de diffamations et injures publiques envers un membre du ministère à raison de ses fonctions et de sa qualité. Il était probablement plus « prudent » d’orienter les débats sur le respect dû à un chef d’État. L’antisémitisme, dans l’affaire, était pourtant flagrant…
Le Crif : Nous avançons dans le temps. Beaucoup plus loin, dans votre livre, vous évoquez un procès pour racisme antiblancs. Pourquoi ?
Emmanuel Debono : Il s’agit d’une affaire qui se déroule en Nouvelle-Calédonie et qui démarre à l’été 1969, après la publication par de jeunes Kanaks, rassemblés autour de Nidoish Naisseline, un étudiant qui a vécu mai 68 à Paris, de tracts explicitement hostiles aux blancs. C’est le début d’un mouvement de contestation anticolonialiste, dans un contexte de changements sociaux et économiques, qui est aussi celui du boom du nickel. Les tracts réalisés sont de facture médiocre. Rédigés en Français mais aussi dans deux langues locales, ils sont peu diffusés. Le ministère public décide toutefois de réagir vigoureusement. Jean-Jacques de Félice, membre de la Ligue des Droits de l’Homme, défend Naisseline mais il a fort à faire face à une administration néocoloniale qui a même essayé de l’empêcher d’accéder aux éléments du dossier pendant la phase d’instruction. Les militants sont condamnés à des peines de prison avec sursis et à des amendes. La cour d’appel confirme le jugement en première instance mais la cour de cassation ne retient que les délits prévus par la loi Marchandeau, écartant celui d’apologie de meurtre. La cour d’appel devant laquelle l’inculpé est renvoyé finit par éteindre l’action publique par la prescription, en 1973. Ce qui est certain, c’est que les juges de Nouméa ont eu la main lourde, probablement motivés par la volonté de briser les velléités d’indépendance. Bien des attaques racistes et antisémites, autrement plus agressives, passent au travers des mailles du filet en métropole, pour des raisons juridiques. Le journal Minute, par exemple, qui s’acharne sur les Nord-Africains à partir de l’année 1964 ne connaîtra aucune condamnation en application de la loi Marchandeau.
Le Crif : Et, nous en venons à la loi Pleven de 1972, l’ultime chapitre de votre livre...
Emmanuel Debono : Oui. La période qui court de la Libération à 1972 est une période au cours de laquelle les militants antiracistes réclament une réforme de la loi. Les obstacles juridiques à son application sont nombreux. La discrimination n’est pas un délit et les associations antiracistes sont systématiquement déboutées. Malgré tout, il y a une intense réflexion autour de la loi, menée par des avocats qui proposent des modifications et deviennent, en quelque sorte, aussi par leur participation aux procès, de bons connaisseurs de ces questions et de leurs enjeux. Le processus de judiciarisation de l’antiracisme est en marche, même si, en définitive, peu de journalistes ou de militants nationalistes sont effectivement condamnés. Le MRAP est à la pointe de cette réflexion. Il est en mesure de proposer une loi dès 1959, portée par des députés communistes. La proposition inspire d’autres versions la décennie suivante, sans que le gouvernement ne juge utile de les inscrire à l’ordre du jour des débats de l’Assemblée nationale. À force de persévérance mais aussi en raison d’un contexte international, le projet du MRAP, amendé, finit par devenir d’actualité. En 1971, la France ratifie la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination, adoptée par l’ONU le 21 décembre 1965. Des réticences demeurent toutefois : René Pleven lui-même ne voit pas l’intérêt d’une nouvelle législation, estimant que la France est bien outillée en la matière. Mais la loi finit par être adoptée à l’unanimité des deux chambres. Elle est promulguée le 1er juillet 1972. Cette unanimité témoigne de l’évolution des mentalités. Elle est aussi indispensable au regard du racisme anti-immigrés qui ne cesse de se développer. La loi Pleven institue le délit de provocation à la haine, à la violence et à la discrimination raciale. Quant aux organisations antiracistes, elles se voient reconnaître le droit de se constituer parties civiles si elles ont cinq ans d’existence et si leurs statuts mentionnent explicitement, parmi leurs objectifs, celui de lutter contre le racisme.
Le Crif : Vous allez poursuivre ce travail ?
Emmanuel Debono : En toute logique, une tome 2 s’imposerait… J’y songe mais il me faut réfléchir à la méthodologie : ce n’est plus du tout la même échelle ; les procès se multiplient à partir de 1972 et ce sont des centaines et des centaines d’affaires qui ont été jugées depuis ! À l’évidence, ce travail est nécessaire, en particulier au moment où survient un débat de fond sur l’opportunité de faire sortir ces délits de la loi sur la liberté de la presse pour les inscrire dans le code pénal ordinaire. L’Histoire est importante : elle montre que les questions qui se posent actuellement n’ont finalement rien de véritablement nouveau. Aujourd’hui comme hier, la question de la liberté d’expression demeure l’enjeu central. Mais il est vrai qu’Internet et les réseaux sociaux dessinent une configuration qui n’a plus grand-chose à voir avec les années d’après-guerre. On sera toutefois surpris de la résonance de certaines problématiques rencontrées par les protagonistes de cette histoire. J’espère que cette recherche pourra nourrir d’une manière ou d’une autre la réflexion et les débats à ce sujet.